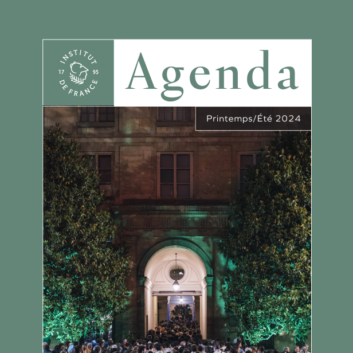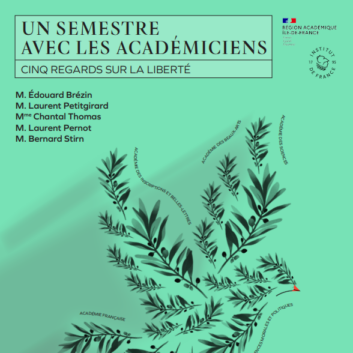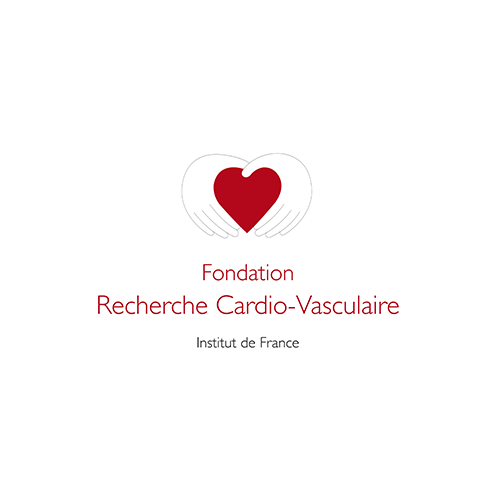11
mars 2024
DU
AU
14
juin 2024
Fondation Recherche Cardio-Vasculaire
Appel à candidature Prix Danièle Hermann
Créée en 2001, la Fondation Recherche cardio-vasculaire – Institut de France a pour but d'aider et de favoriser le développement de la recherche médicale et...
Découvrir
12
avril 2024
DU
AU
27
juin 2024
Fondation Lefoulon-Delalande
Appel à candidatures pour les bourses de recherche
Créées en 2001, les Bourses de Recherche de la Fondation Lefoulon-Delalande ont pour but de promouvoir les activités d’un chercheur post-doctorant travaillant à plein temps...
Découvrir
17
octobre 2023
DU
AU
15
janvier 2024
Fondation Joseph Wresinski
Appels projets. Émergence et diffusion d’une culture du refus de la misère
La Fondation Joseph Wresinski-Institut de France apporte, sous forme de bourse ou de subvention et dans la limite des ressources disponibles, un soutien à des...
Découvrir
26
octobre 2022
DU
AU
15
janvier 2024
Fondation Lefoulon-Delalande
Appel à candidature – Grand Prix scientifique 2024
Créé en 2002, le Grand Prix est décerné chaque année à une personnalité ayant apporté une contribution scientifique importante en physiologie, biologie ou médecine cardio-vasculaires....
Découvrir
30
octobre 2023
DU
AU
31
janvier 2024
Fondation NRJ
Appel à candidature – Prix scientifique 2024
Créée en 1999, la Fondation NRJ de l’Institut de France se fixe pour objet de concourir à la recherche médicale, notamment dans le domaine des...
Découvrir
16
novembre 2023
DU
AU
15
février 2024
Fondation Charles Defforey
Appel à candidature du Grand Prix humanitaire 2023
La Fondation Charles Defforey – Institut de France, sise 23 quai Conti à Paris 6ᵉ, fondation abritée par l’Institut de France, représentée par son Président,...
Découvrir
15
novembre 2023
DU
AU
15
février 2024
Fondation Recherche Cardio-Vasculaire
Appel à candidature bourses cœurs de femmes
La Fondation Recherche Cardio-Vasculaire – Institut de France poursuit son engagement et lance pour l’année 2024 un nouvel appel à projets de recherche destiné à...
Découvrir
13
décembre 2023
DU
AU
15
février 2024
Fondation Simone et Cino Del Duca
Appel à candidature pour le Grand Prix scientifique 2023
La Fondation Simone et Cino Del Duca de l’Institut de France décerne chaque année alternativement au titre des disciplines relevant des deux divisions de l’Académie...
Découvrir
16
novembre 2024
DU
AU
16
février 2024
Fondation Charles Defforey
Appel à candidature – Grand Prix pour l’apprentissage du Français 2024
La Fondation Charles Defforey – Institut de France, sise 23 quai Conti à Paris 6ᵉ, fondation abritée par l’Institut de France, représentée par son Président,...
Découvrir
16
novembre 2023
DU
AU
24
février 2024
Fondation Charles Defforey
Appel à candidature du Grand Prix culturel 2024
La Fondation Charles Defforey – Institut de France, sise 23 quai Conti à Paris 6ᵉ, fondation abritée par l’Institut de France, représentée par son Président,...
Découvrir
19
novembre 2023
DU
AU
28
février 2024
Fondation Charles Defforey
Appel à candidature du Grand Prix scientifique 2024
ENGLISH VERSION FORMULAIRE DE PROPOSITION APPLICATION FORM La Fondation Charles Defforey-Institut de France décernera un prix intitulé « Grand Prix scientifique 2024 de la Fondation...
Découvrir
27
novembre 2023
DU
AU
1
mars 2024
Fondation Michel Serres
Prix Michel Serres de thèse interdisciplinaire
La Fondation Michel Serres a souhaité créer un « Prix Michel Serres de thèse interdisciplinaire » d’un montant de 3 000 euros, destiné à récompenser...
Découvrir
30
octobre 2023
DU
AU
28
mars 2024
Fondation unité Guerra-Paul-Beaudoin-Lambrecht-Maiano
Appel à candidatures Prix Unité Guerra-Paul-Beaudoin-Lambrecht-Maiano
Créée en 2006, la Fondation Unité-Guerra-Paul-Beaudoin-Lambrecht-Maiano de l’Institut de France se fixe pour objet de soutenir la lutte contre la douleur, notamment en soutenant la...
Découvrir
28
février 2024
DU
AU
9
avril 2024
Fondation Feuilhade
Prix de la Solidarité de Proximité
Pour la 16e année, La Fondation Feuilhade-Institut de France décernera à l’automne son Prix de la Solidarité de Proximité Habitat participatif, habitat partagé, habitat inclusif…...
Découvrir
17
janvier 2023
DU
AU
12
avril 2024
Fondation Allianz
Appel à candidature 2024 pour le prix de recherche
Créé en 1984, le prix de recherche de la Fondation Allianz-Institut de France est destiné à récompenser chaque année le responsable de recherches médicales ou...
Découvrir
1
février 2024
DU
AU
19
avril 2024
Fondation Yves Cotrel
Appel à projets 2024
Dès sa création en 1999, la Fondation Yves Cotrel pour la recherche en pathologie rachidienne a concentré son champ de recherches sur le sujet de...
Découvrir